Un modèle dynamique de crise (1)
Étude sur le futur proche du capitalisme
La probabilité existe-t-elle vraiment ? Et que serait-elle alors ? Quant'à moi, je répondrais qu’elle n’existe pas. Certains me demandent alors ironiquement pourquoi je m’en occupe. Eh bien, je pourrais dire vice-versa et sans contradiction que la probabilité règne partout, qu’elle est ou, au moins, devrait être, notre guide de pensée et d’action, et que c’est pour cela qu’elle m’intéresse.
Bruno de Finetti, mathématicien
Albert Einstein [avec la théorie de la relativité] ne fut pas le porte-drapeau de l’antidéterminisme, le champion de la théorie philosophique de l’incertitude, et pas même de la méthode probabiliste, qui était d’ailleurs connue des classiques et dont les lois étaient étudiées depuis Laplace, et il ne se serait pas contenté de dire – s’il s’était piqué de politique – de dire : il n’est que très probable que la bourgeoisie et son idéologie aillent au diable.
Amadeo Bordiga, révolutionnaire
Nous affronterons le problème de la crise capitaliste en partant du concept de prévision qui est, au fond, celui de la science en général. C’est sur cette base que nous allons analyser un modèle de crise élaboré par notre courant, la Gauche Communiste « italienne », au milieu des années cinquante ; un modèle montrant, par une projection des données sur 20 ans — jusqu’en 1975 environ —, l’existence d’un point catastrophique, une singularité révolutionnaire. On donnait, parmi la grande masse des données recueillies, une importance fondamentale et une valeur symbolique à la minéralisation de la vie humaine, c’est-à-dire à l’écrasement du monde biologique — dont notre espèce fait partie — par la production minérale. La méthode utilisée alors est la même que celle qui nous permet aujourd’hui de comprendre la structure d’une crise que depuis un certain temps même les économistes définissent comme systémique. Ses racines plongent dans certaines contre-tendances que le Capital met naturellement en action afin de conjurer la chute du taux de profit. En particulier : augmentation du niveau d’exploitation du travail, diminution de la valeur du salaire, expansion du commerce extérieur, expansion du crédit ; tous éléments de ce qu’on appelle aujourd’hui la « mondialisation ». Nous affirmons en conséquence que la crise « actuelle » dure depuis trente ans, qu’elle est une crise chronique irréversible, et qu’elle se manifeste par le degré extrême de minéralisation non seulement de la vie humaine, mais de toute la biosphère. Ce fait, qui semblait à nos adversaires, il y a un demi-siècle, de la science-fiction, est maintenant reconnu par les institutions officielles de la bourgeoisie internationale. Il s’agit d’une des plus éclatantes capitulations face à la théorie révolutionnaire qui a pris le nom de Marxisme.
Indéterminisme, certitude, prévision
Nous faisons « nos excuses aux malandrins qui voudraient un marxisme sans mathématiques et donc sans chiffres », comme le disait Bordiga, et commençons par le début, c'est-à-dire de quelle manière, depuis que le monde est monde, l’homme a cherché à se construire des modèles abstraits afin de prévoir les événements à venir. Nous nous perdrions dans des discussions académiques si pour histoire nous n’entendions pas la dynamique nous entraînant vers le futur et la compréhension de ses lois. D'ailleurs, même l’historiographie bourgeoise ne se limite plus à redécouvrir le passé à travers des documents, à classer les événements et à les organiser par enchaînement chronologique. Elle en est arrivée à essayer de donner un sens aux événements dans un cadre théorique dynamique tenant compte de l’économie, de la géographie, des différentes périodes de développement et des ensembles sociaux. La différence entre la conception bourgeoise et communiste du futur réside dans le fait que la première prévoit des « progrès » dans les techniques et dans l’évolution politique de la forme capitaliste alors que la seconde en prévoit la fin par la destruction du pouvoir politique et par l’avènement d’une nouvelle société basée sur des prémisses antithétiques.
Durant de nombreux siècles, l’histoire de l’homme a été séparée de ce qu’on appelle les sciences de la nature. Mais pour le courant révolutionnaire de la période capitaliste, toute recherche de lois régulant le comportement de notre espèce ne peut être que science de la nature. Et nous notons avec satisfaction que la bourgeoisie elle-même ait été obligée de capituler devant ce fait, découvrant qu’il est possible de traiter suivant des modèles mathématiques les faits humains, comme si dès aujourd’hui il y avait une anticipation sur une discipline du futur, basée sur des méthodologies encore embryonnaires, mais que certains scientifiques bourgeois appellent « physique de l’histoire », en dépit de la tradition de la séparation entre les cultures.
La persistance du manque de connaissances sur une grande partie des phénomènes naturels a emporté la conception scientifique dominante vers une dérive indéterministe de type philosophique, c’est-à-dire métaphysique. S’il est vrai qu’il est intrinsèquement impossible de connaître à la fois le mouvement et la position d’une particule subatomique — mais ceci est également vrai de problèmes plus banals, au niveau mécanique macroscopique, par exemple tenter de mesurer « avec précision » la vitesse d’une automobile avec un chronomètre —, il n’en dérive pas que l’ensemble de la nature soit soumis à des lois d’indétermination. Il en découle seulement que notre connaissance doit passer par la délimitation préventive des résultats recherchés et du degré de précision voulu. Nous pouvons dans cette mesure parfaitement connaître la vitesse d’une automobile ou le comportement d’une particule. Le physicien Richard Feynman disait que la physique n’est pas la science du pourquoi, mais du comment. Le pourquoi est, aujourd’hui, de la métaphysique, et personne ne peut dire s’il en sera toujours ainsi. Personne aujourd’hui ne peut — et peut-être personne ne pourra — dire pourquoi les corps « tombent » les uns sur les autres ; mais la découverte des lois de la gravitation et du mouvement a permis le développement de la physique, de la mécanique, des mathématiques et de tout un appareil de connaissances de l’univers et de notre vie de tous les jours.
Pour en revenir à l’histoire, l’alternative entre indéterminisme probabiliste et déterminisme mécanique quant à la prévision sur le futur ne peut que fournir des arguments pour une discussion entre scientifiques bourgeois et prêtres — ainsi que le démontre le scandale soulevé par le pape Ratzinger sur la question du relativisme et de la certitude. Lorsque l’homme se pose un problème et veut le résoudre, il a besoin de certitudes, qui sont absolues dans un cadre de référence établi et partagé : le paysan a besoin de savoir quand semer ; s’il se trompe d’une semaine, il n’y aura pas de grave conséquence, mais il ne peut absolument pas se tromper de saison. Dans une course de cent mètres, où les écarts sont comptés en millièmes de seconde, l’utilisation d’une clepsydre n’aurait aucun sens, il faut absolument un chronomètre. Tout problème offre une solution qui possède une certitude absolue quand elle est encadrée de manière formellement correcte, c'est-à-dire selon les conventions qui, au cours de la vie de notre espèce, ont été d’une grande utilité pour « mettre bas de flamboyantes connaissances ». On peut aussi invoquer la certitude mathématique lors de l’étude de phénomènes complexes qu’il est impossible d’affronter de manière analytique à condition d’avoir présent à l’esprit le fait que dans tout système complexe les parties qui le forment interagissent et donc provoquent continuellement un changement d’état, en équilibre instable entre le chaos et un nouveau niveau d’organisation. Ce n’est qu’en précisant ceci que l’on peut ranger au placard tant les absolus philosophiques que le relativisme/indéterminisme vulgaire.
La société humaine est un système hautement complexe et les prévisions sur son devenir sont particulièrement difficiles. Ceci étant, il est possible de retrouver la trace en son sein d’un ensemble de lois qui règlent son fonctionnement, ce qui représente en soi la possibilité de formalisation afin d’en définir des certitudes. Tout physicien a par exemple l’absolue certitude que dans une biosphère de dimensions finies il n’est pas possible de poursuivre éternellement une croissance exponentielle de la production. Sur la base de cette certitude, nous pouvons introduire un calcul pour chercher à comprendre quand le système arrivera à ses limites — avec ses conséquences sociales. Et puisque le système analysé est non seulement complexe, mais extrêmement dynamique, nous devons nous mettre nous-mêmes en garde — ainsi que ceux qui s’attendent à ce que le changement d’état continuel doive être reproduit dans le modèle formel et se vérifier expérimentalement dans la réalité.
Nous ne pouvons malheureusement pas faire d’expériences avec la société ; on ne peut pas la reproduire en laboratoire, mais seulement la simuler. Et, comme on le sait, la simulation n’est pas la réalité, de la même manière qu’une carte n’est pas le territoire représenté lui-même. Il semble que ce soit une situation sans voie d’issue, mais la méthode scientifique ne s’arrête pas à si peu : si une carte ne réussit jamais à reproduire fidèlement le territoire concerné, on contournera l’obstacle en poussant à l’extrême son niveau d’abstraction, de manière à éliminer les informations superflues et donc trompeuses. On peut ainsi passer d’une carte détaillée comme celle du Pré St Gervais à celle des transports publics d’une grande métropole qui ne mentionne que les stations, les correspondances, les lignes que l’on symbolise par des traits de couleur et que seul notre esprit peut convertir en réalité. Cependant, les bus et les métros fonctionnent bien le long de ces lignes et s’arrêtent bien aux endroits représentés par des points. Grâce à l’abstraction élevée du modèle/carte du métropolitain, nous pouvons prévoir avec exactitude où arriveront les trains réels dans des centaines de stations.
Conditions initiales et environnantes
Le problème de la prévision est un casse-tête ancien. Des aruspices aux élaborateurs électroniques il y a apparemment un gouffre, mais dans certains cas, la prévision a la même efficacité. Nous devons au préalable partager certains éléments préliminaires avec le lecteur. En mécanique classique, il existe des principes élémentaires synthétisés par Laplace à l’apogée de la révolution illuministe : les conditions initiales d’un système étant connues, toutes ses variations dans le temps seront connues suivant des lois drastiquement déterministes ; l’unique limite est la connaissance effective de ces conditions, alors que un esprit infini pourrait calculer l’évolution de l’univers entier à partir d’un moment donné ; là où un tel esprit ne peut arriver, il ne reste aux pauvres capacités humaines que l’observation statistique. Les critiques hâtives du « mécanicisme » de Laplace ne devraient pas oublier qu' on ne peut se débarrasser des échelons révolutionnaires de l’escalier de la connaissance.
L’expédient de l’esprit infini sert à souligner le fait que pour l’homme normal est niée la connaissance de la manière dont évolue l’univers à partir des conditions à un moment donné, mais également la connaissance précise de ces conditions. De là la difficulté de prévision concernant des phénomènes ne serait-ce qu’un peu complexes, problème étudié par Poincaré et d’autres un siècle après Laplace, point de passage vers les théories suivantes, de la relativité, des quanta, du chaos, de la complexité.
La prévision basée sur la méthode scientifique se différencie des prédictions astrologiques, des prophéties et des utopies, dans la mesure où elle arrive, à partir d’un état connu basé sur des règles — invariants — constatées dans le temps, à en déduire un état inconnu. Par exemple, dans un système dominé par des mouvements arbitraires et chaotiques, aucune prévision ne serait possible sans l’individualisation d'un certain ordre et d'une certaine invariance. Nous savons aujourd’hui que même les systèmes chaotiques présentent des phénomènes d’ordre émergent, et l’on parle désormais sans problème de chaos deterministe. Régularité et invariance des phénomènes signifient la présence de lois sous-jacentes. Si les lois ont été déterminées il est alors possible de réaliser des modèles abstraits et avec eux revenir à la complexité du concret » (Marx) pour vérification. Tout cela fait partie du bagage scientifique commun à l’ensemble de l’humanité : la conception scientifique courante ne pourra changer qu’avec le changement de forme sociale, après la destruction du pouvoir bourgeois et donc l’extinction de l’idéologie dominante actuelle.
Ces quelques points servent à introduire une question importante : en dépit d’une conception scientifique actuellement partagée par les forces bourgeoises et les forces révolutionnaires — il n’existe pas et n’existera pas de « science prolétarienne » —, il y a une forte différence dans les résultats, tant dans l’identification des lois du système — état connu — que, en conséquence, dans les conclusions qu’on en tire sur son futur — état inconnu. La différence n’est pas de type théorique, mais idéologique pour les bourgeois et politique pour les révolutionnaires, une situation identique à celle existant entre les inquisiteurs et Galilée. Et puisque le point de départ du système et son évolution future ne peuvent être simultanément de deux types différents, un des deux est forcément faux.
Il se dit que classes, argent, richesse, pauvreté et exploitation ont toujours existé et donc existeront toujours. C’est faux. L’homo faber est vieux d’au moins deux millions d’années et les sociétés de classes n’ont que 5 000 ans d’existence. Argent, richesse et pauvreté depuis moins de 3 000 ans. Les sociétés de classe couvrent tout au plus 2,5 pour mille de l’histoire humaine. Les conditions initiales du système sont communistes à 997,5 pour mille, et donc les sociétés de classe ne représentent qu’une faible perturbation dans les conditions environnantes. La dernière, la plus insignifiante de toutes, prétend même avoir le monopole idéologique pour la période entière, interprétant selon sa propre métaphysique tant les deux millions d’années passées que les millions d’années futures.
Au sein de l’insignifiante phase classiste et propriétaire, il y a des invariants qui passent d’une époque à l’autre selon d’intéressantes transformations. L’argent, par exemple, passe d’objet matériel destiné à l’échange à un niveau à peine supérieur au troc, à un signe de valeur dématérialisé possédant une vie autonome en tant que Capital. De même pour la famille : elle passe du groupe élargi qui produit et se reproduit en tant que base de l’ancienne société, à l’inutile atome social, simple intermédiaire au service de la consommation et de la propriété. Ou encore le travail : d’activité intégrée dans la vie de l’être humain à activité aliénée, dont le seul but est de vivifier le Capital. Ou bien l’État, l’institution la plus jeune de toutes : d’instrument au service de la société pour coordonner ses activités à instrument d’oppression entre les mains d’une seule classe.
Les conditions initiales du système, connues, qui sont valides pour toute la période de la société divisée en classes, si l'on s'en tient aux invariants présentent donc, dès l’étape précapitaliste, des transformations qui permettent de mettre en évidence une dynamique ultérieure pouvant être projetée dans le ,futur pour la prévision de résultats évolutifs ou catastrophiques — inconnus —. Mais, comme le dit Engels, l’étude de l’homme nous fait mieux comprendre l’évolution des hominidés : arrivés à la phase mûre du capitalisme, nous possédons bien plus d’informations sur le système tout entier, car entre-temps, au cours de ces cinq mille années, il s’est étudié lui-même, s’est fortement structuré et a pris des caractéristiques impensables dans les phases précédentes. Par exemple, certaines de ses organisations, comme celles qui forment l’État, y compris le gouvernement, ne répondent plus à des hommes ou des groupes plus ou moins puissants, mais à des automatismes imposés par le système lui-même. Aujourd’hui, un gouvernement est plus semblable à un thermostat qu’à un centre de pouvoir à travers lequel se manifeste la volonté d’une classe. Face à la puissance anonyme du marché, gouvernements en banques centrales ne font que suivre les conséquences provoquées par les mouvements d’un Capital désormais complètement autonome, qui n’a plus de liens avec les propriétaires particuliers de quotes-parts désormais indiscernables dans la masse d’argent en mouvement à l’échelle mondiale. C’est un signe que le système capitaliste dans son ensemble a rejoint ses limites : il n’est plus gouvernable, il est hors contrôle. C’est sur cette base que menace la catastrophe.
Modèle de prévision de 1956
Ainsi que nous l’avons vu plus haut, tout expédient pour décrire la réalité qui ne soit pas un simple étalage — montrer cette chose — est un modèle. Si par exemple en montrant une pierre on dit également : « ceci est une pierre », on a déjà introduit une modélisation de la réalité. Si je n’ajoute rien d’autre, ceci veut dire que je fais abstraction de détails particuliers et enlève du modèle toute généralisation du mot « pierre » comme les galets, le gravier, les cailloux. Évidemment, si j’appelle également ces derniers « pierre » j’introduis la généralisation qui était précédemment exclue. Dans tout modèle, il y a donc une dose inévitable de subjectivité qu’on ne peut dépasser que par le partage des signes nécessaires pour réaliser le modèle lui-même. Ce préalable est important. Car un modèle social réalisé par un révolutionnaire sera complètement différent d’un modèle réalisé par un conservateur, même si l’objet de la modélisation est le même. Théoriquement, ceci ne devrait pas arriver pour la pierre, alors qu’au contraire nous savons trop bien qu’il se forme des courants interprétatifs y compris sur des éléments de la réalité apparemment neutres. Nous disons tout de suite que dans notre étude sur le futur du capitalisme nous ne serons pas neutres. Nous ne pourrions l’être même si nous le voulions — le pourquoi sera clair d’ici peu.
À partir de septembre 1956 et pour près de deux ans, notre courant se dédia, entre autres, à une analyse minutieuse de l’économie avec un soin particulier concernant les données de la production industrielle des principaux pays — et du monde — pour démontrer les limites du capitalisme sur la base des lois découvertes par Marx. On réalisa ainsi un modèle — appuyé par une masse impressionnante de données sous forme de tableaux et de graphiques — qui offrit la vérification expérimentale des thèses théoriques : la variation dans le temps des valeurs de la production industrielle montrait une diminution constante des accroissements relatifs (presque tout le matériel est disponible dans le volume Le cours du capitalisme mondial, publié dans Il programma comunista de 1956 à 1958, reprit Edizioni del PCInt, Florence 1991). Et puisque l’évolution de la production industrielle équivaut toujours au taux de profit, c’est-à-dire survaleur/(capital constant + capital variable), la démonstration expérimentale de la loi marxiste de la chute tendancielle du taux de profit était faite. Il était permis de prévoir, pour les plus grands pays, une crise globale qui aurait rendu superflu l’adjectif « tendancielle » :
« Il est évident que nous ne sommes pas à la veille de la Troisième Guerre Mondiale ni de la grande crise d’interguerre, qui ne pourra se développer que dans quelques années, lorsque le mot d’ordre de l’émulation et de la paix aura dévoilé son contenu économique : marché unique mondial. La crise n’épargnera alors aucun État. Une seule victoire est pensable aujourd’hui pour la classe travailleuse, la victoire doctrinale. Le but, dans un second temps, est la victoire d’organisation. Ce n’est que dans une troisième phase historique que l’on pourra voir remise sur le terrain de l’histoire la question du pouvoir. Pour ces trois étapes, le thermomètre est la rupture d’équilibre à la charge – d’abord et surtout – des USA et non de l’URSS. » [Le cours… p. 147].
À l’époque on ne parlait pas encore de « mondialisation », mais le phénomène était prévu, de même qu’était prévue la diminution des augmentations relatives de la production industrielle, c'est-à-dire du taux de profit. C’était alors la Russie à montrer des taux élevés de croissance initiale, aujourd’hui c’est la Chine. Ce résultat correspond aussi à une loi de la nature, celle de la diminution de l’accroissement relatif dans la croissance des êtres vivants, étudié par une discipline spécifique, l’auxologie. Loi vérifiable également dans certains cas de croissance quantitative de matière inanimée quand il y a un apport de quantités constantes de matériel, comme le cas du volume d’eau dans un récipient sous un robinet ouvert ou du volume d’un objet soumis à la galvanoplastie — un apport de 10 pour un volume initial de 100 représente une croissance de 10 % ; un apport ultérieur de 10 représente 10/110 = 9,09 %. En général, la théorie moderne des systèmes met en évidence la validité de la loi pour la dynamique de multiples phénomènes dont le diagramme de croissance présente une courbe en forme de S aplati : une croissance rapide de type exponentielle dans la première partie, un point de flexion — changement de tendance —, et une seconde partie de forme asymptotique vers un équilibre — ou bien vers la mort si le système ne vit que de croissance. Une telle courbe résulte également de la Théorie Générale des Systèmes due à Ludwig Von Bertalanffy (1940), théorie qui, même si elle n’est pas nommée dans les travaux en question, y est reflétée. Nous trouvons une autre analogie dans la théorie «fractale» des cycles, découverte par Mandelbrot dans les années soixante et systématisée mathématiquement dans les années soixante-dix : tout cycle, qu’il soit bref ou long, présente toujours les caractéristiques d’une courbe en S . À tous les niveaux du système émergent des caractères d’autoressemblance.
Dans ces mêmes travaux, on avait ajouté aux données sur la production industrielle/chute du taux de profit celles concernant la «minéralisation sociale» auxquelles on avait attribué une valeur particulière, car elles concernaient non seulement le développement du système, mais également les possibles attitudes du prolétariat. De 1850 jusqu’à la Grande Crise de 1929, la production de matières premières minérales et de produits manufacturés industriels avait augmenté en valeur du même ordre de grandeur, 34 fois pour la première et 21 pour la seconde. L’écart s’expliquait par la croissance de la rente foncière face à la diminution de la valeur des produits industriels due à l’augmentation de la productivité. Mais au cours de la même période, la production de matières premières agricole, bien que fût alors opérative la lois de la rente, n’avait crû que de 6,4 fois, c'est-à-dire cinq fois moins que la production minière. Démonstration de la sénilité du capitalisme, entre 1929 et 1956 la production totale n’avait augmenté que de 2,4 fois, une valeur inférieure en terme d’augmentation annuelle par rapport aux périodes précédentes : 4,5 % par an de 1850 à 1929 et 3,2 % par an de 1929 à 1956.
La dynamique historique était claire : à l’aube du capitalisme industriel, pendant la phase manufacturière du début du XIXe siècle, la production industrielle représentait 10 % de la production agricole ; en 1870 : 16 %, en 1906 : 39 %, en 1913 : 46 %, en 1929 : 53 %, en 1956 : 62 %. À l’époque, on pensait à un rapport moins déshumanisé que celui auquel nous faisons face (en 2007 : 2 500 % !). L’agriculture, dans le monde, restait prédominante, et la majeure partie des pays peinaient à sortir des conditions de sous-développement provenant de l’oppression coloniale. En déduisant l’augmentation de population, l’augmentation de la production industrielle par personne en un siècle avait été de 1,5 %/an, et celle de la production agricole de 0,5 %/an, à savoir trois fois moins. Et ceci, pendant que la masse des profits — malgré la baisse du taux d’accroissement — augmentait énormément. Conclusion: le développement du capitalisme affame la masse de la population humaine, en lui soustrayant de la nourriture au profit des machines. C’est le phénomène des «ciseaux» entre production industrielle et production agricole, déjà prévu par Marx et pris en considération par tous ses élèves conséquents. Toute projection dans le futur ne pouvait que rendre un verdict de mort pour un tel système. L’inconnu était le temps que cela prendrait.
Le modèle donnant des réponses sur les événements avec une telle précision, pouvait-il également en donner sur le calendrier ? Quand les courbes de la production agricole et de la production minérale se rencontreraient-elles ? Car il était clair, avec les données disponibles, que l’augmentation de la production agricole de 0,5 % par personne, ne pouvait résister à l’épreuve d’une guerre, d’une récession, ou pire encore de la simple évolution de la situation de décroissance telle qu’elle était. La tendance portait à une date aux environs de 1975, «année qui, selon nos espérances, verra la mort de la forme capitaliste» (Corso, p. 117). On mettait naturellement en garde le lecteur sur le fait qu’il s’agissait d’une hypothèse sur un développement possible et qu’il aurait été nécessaire de se fonder sur un plus grand nombre de données quantitatives pour pouvoir sortir des déductions essentiellement qualitatives, par exemple en confrontant les séries de données sur la production de l’acier avec celle sur le pain, le sucre, le coton, etc. afin d’en tirer des courbes servant à «mettre en évidence la rencontre entre la minéralisation de la vie et les limites de sa démence, en tant que la vie appartient à l'organisme, la mort appartient au froid métal» (Corso p. 117).
Comme on le sait, il y eut une grave crise du système capitaliste en 1975 qui explosa à l’occasion de la hausse vertigineuse des prix des matières premières d’importance stratégique — surtout celle du pétrole (non plus de l’acier) et des principales productions agricoles. L’augmentation des prix ne fut naturellement pas la première cause de la crise, mais celle-ci intervint à un moment où le taux de profit était déjà bas et où il n’y avait pas de marge permettant de transférer une partie de la valeur à la rente. C’est au cours de ces années que changea l’organisation du capitalisme mondial, mais ni la catastrophe économique prévue, ni la guerre et encore moins l’assaut révolutionnaire du prolétariat n’eurent lieu. Une multitude de critiques improvisés se mirent à hululer, avec la sagesse de ceux qui jugent après, que le modèle était «faux», qu’il y avait une erreur théorique de fond. Ils voulaient critiquer une proposition scientifique sans rien connaître de la science. Il faut briser tout de suite cet argument : depuis qu’existe la science, tout le monde sait (ou devrait savoir !) que lorsqu’on travaille sur un système plus ou moins complexe le caractère scientifique n’est pas donné par le résultat prévisionnel obtenu, mais par la méthode avec laquelle on l’a formulé. Même si l’échec de la prévision compromet son auteur «aux yeux du peuple», l'insuccès n’est pas une condition suffisante pour jeter les connaissances sur lesquelles repose la méthode prédictive imaginéè et utilisée. La phrase citée précédemment — «année qui, selon nos espérances, verra la mort de la forme capitaliste» (Corso, p. 117) — montre que, si les conditions initiales (de 1956) prises en compte étaient correctes, c’est l’environnement de celles-ci qui avait changé. Il n’est pas difficile d’imaginer que, face à une situation dynamique, le modèle lui-même doit être «dynamisé» par l’apport de données mises à jour, de manière à produire une rétroaction sur les résultats du modèle lui-même. La date de 1975 n’était valable que sur la base des données de départ. D'autre part, notre courant signalait «admettre qu’une telle date ne peut provenir d’aucune équation et n’est le résultat que d’inductions probabilistes» (Structure économique et sociale de la Russie d’aujourd’hui, p. 224 de l’édition italienne). Des inductions ultérieures auraient pu faire changer la prévision. Le caractère scientifique de la méthode utiliséè pour explorer ce qui était encor inconnu en 1956 ne peut être mis en discussion du fait que ces hypothèses sur le possible se soient ou non réalisées.
Toutefois, le modèle se montra résistant au changement des conditions de l’environnement, et, si ses prévisions ne se réalisèrent pas en totalité, le monde capitaliste entra néanmoins dans une crise irréversible dans laquelle nous sommes toujours. Qu’était-il arrivé de si éclatant pour que la position du capitalisme change à ce point et fasse que les positions dénoncées à grands cris comme «erronée», le soient sinon du point de vue de la crise, au moins du point de vue de l’éclatement de la guerre et de la révolution ? Quatre événements s’étaient passés : 1) le dollar, devenu médiateur monétaire du Capital mondial, s'était autonomisé par rapport aux Etats-Unis (xénodollars), et ces derniers commençaient l'époque de ratissage de rente dans le monde entier, situation qui perdure aujourd’hui ; 2) la crise pétrolière avait explosé, et le décuplement du prix du pétrole avait consenti le ratissage immense et capillaire de capitaux provenant de la rente (pétrodollars) recyclés par les pays producteurs dans le secteur financier ; phénomène qui avait provoqué l’augmentation démesurée des liquidités du système du crédit, auxquels les grandes banques et les sociétés multinationales avaient pu accéder de manière centralisée, recevant ainsi une énergie supplémentaire ; 3) le cycle colonial était terminé et une grande partie des pays avait pu commencer son accumulation primitive, bénéficiant de l’excédent mondial de capitaux financiers, spécialement dans le secteur des moyens de production, moteur depuis toujours de l’économie capitaliste ; 4) la généralisation à l’échelle mondiale des semences hybrides à haut rendement, des moyens modernes de production agricole et des engrais chimiques, avec en conséquence une baisse de la biodiversité alimentaire et une augmentation spectaculaire de la production agricole de masse (la production mondiale de céréales tripla entre 1950 et 1990) aux dépens du petit paysan exproprié et jeté dans les bidonvilles.
Ce cycle d’autosauvetage du Capital avait permis de renforcer ce que Lénine considérait comme la bête noire de la révolution à l’époque de l’impérialisme : la corruption du prolétariat.
Avec le déclin désormais définitif de l’Angleterre et l’absence totale d’influence de l’URSS sur l’économie mondiale, les États-Unis devinrent la seule puissance hégémonique, délièrent le dollar de leur propre économie en le rendant de fait inconvertible, et obligèrent le reste du monde à l’utiliser comme unique monnaie de change international et de réserve. À travers la rente, le contrôle des flux financiers et l’action des multinationales, les Américains commencèrent à opérer un gigantesque prélèvement de survaleur sur toute la planète, prélèvement qui ne fut pas contesté par les principaux pays impérialistes, ceux-ci considérant (avec justesse) qu’ils avaient tout intérêt à alimenter le pays qui était «la locomotive de l’économie du monde».
Prévision, possibilité, probabilité
Nous n’avons pratiquement rien à ajouter au modèle de prévision utilisé par nos camarades des années cinquante. En outre, nous avons accès à des milliards de données (bien trop) à travers Internet. Il n’y a donc qu’à continuer de mettre à jour les séries historiques et d’en tirer des conclusions en les projetant pour les années futures. Il faut bien sûr tenir compte du fait que les techniques ont évolué dans tous les champs de la production, que la population mondiale a entre-temps doublée, que sont apparus sur la scène des pays comme le Japon, la Corée, la Chine, l’Inde, le Brésil, et que face à ceux-ci la part de la valeur produite par les pays à capitalisme ancien baisse, enfin que la masse des salariés dans le monde s’est accrue pour arriver à 1,3 milliard d’individus, sans tenir compte des chômeurs et des travailleurs à temps partiel (30 % de la force de travail disponible, soit presque un milliard).
Avant d’analyser les données, nous devons préalablement approfondir ce que nous avons affirmé plus haut, en disant qu'il aurait été clair pourquoi nous ne pouvons être neutres. Quiconque effectue une prévision doit se baser sur la méthode inductive, c'est-à-dire sur la connaissance des données qui ont précédé et déterminé la situation présente, qui à son tour débouche sur la situation à venir. Sur la méthode inductive se greffe naturellement la méthode déductive, c'est-à-dire un traitement des données à des fins théoriques, de connaissance (dans ce sens, les procédés mathématiques sont indiscutables). Mais pour étudier le futur, il n’existe que l’induction basée sur les données disponibles. Un exemple donné par tous les manuels est celui de la proposition suivante : «tous les cygnes sont blancs»… jusqu’à ce que l’on découvre des cygnes noirs en Australie. Par ailleurs, pour connaître la date d’une éclipse du soleil ou de la lune, il suffit de se baser sur les données précédentes, et l’on aura une précision dans la prédiction très grande, même à une distance de plusieurs décennies. Mais les données précédentes ne nous permettent que difficilement de savoir s’il va pleuvoir ou non dans trois jours. Cette confrontation classique entre un système newtonien et un système chaotique nous oblige à apporter des correctifs au concept de prévision, et à parler par exemple de possibilité et de probabilité. Si on considère un événement comme impossible, toute prévision est inutile. Si on considère un événement comme seulement probable, on aura un niveau aléatoire dans les prévisions. Le lecteur aura noté que la formulation est : «considéré impossible ou probable» ; l’observateur «considère» savoir quelque chose a priori. On introduit un élément de subjectivité qui en soi exclurait le caractère scientifique de la recherche.
Ici, les choses peuvent se compliquer jusqu’à précipiter dans la philosophie. Gramsci, par exemple, soutenait que la volonté influence la prévision, et ceci est certain chaque fois que des individus ou des groupes cherchent à projeter leur propre futur ; mais ce n’est que de l’idéalisme si l’on sort du cadre plaçant l’individu comme partie d’un tout, sans influence sur le sort de l’univers environnant — il ne s’agit pas ici de s’amuser avec le paradoxe de l’œuf et de la poule : pour nous, ce ne sont pas les Napoléon qui font l’histoire, mais au contraire l’histoire matérielle qui en produit d’ailleurs bien trop, avec sa cohorte de saints, de prophètes et de démons du mal. Afin de ne pas tomber dans la philosophie, nous couperons court avec l’affirmation suivante : en tant que révolutionnaires, nous retenons a priori que le système capitaliste est transitoire, qu’il sera abattu comme les différents systèmes qui l’ont précédé, et qu’il lui sera substitué un autre caractérisé par le fait d’en être sa négation pour toutes les catégories sociales. Cette affirmation est licite, car 1) elle est basée sur les lois du développement de l’humanité, lois que l’on peut démontrer empiriquement ; 2) ces lois produisent une force capable de «renverser la praxis» et de participer à la vérification des changements que cette même force avait prévue.
À l'évidence, la même opération est licite pour les bourgeois. Ils retiennent pour leur part, en tant que bourgeois, que le système capitaliste est en éternelle évolution (progrès), qu’il n’existe pas de classes, mais un éventail de possibilités servant à classer les hommes suivant les principes de la saine concurrence, ceux-ci pouvant profiter des opportunités pour monter les échelons, et qu’ils peuvent «gouverner», c'est-à-dire entreprendre des actions dans le but de contrôler le Capital de manière à ce que la croissance et le développement soient assurés par la réforme continuelle des mécanismes économiques et politiques. Une observation inductive à l’échelle des trois derniers siècles lui donne raison : aucune force n’a jamais fait sauter le capitalisme et pour le moment il ne s’en manifeste aucune en état de le faire à un horizon visible et raisonnable.
La meilleur viendra lorsque nous regarderons les chiffres fournis par les bourgeois afin de démontrer le contraire de ce qu’ils veulent démontrer sur la base des mêmes données. Puisqu’il n’existe ni une histoire ni une science «prolétarienne», nous et les bourgeois puisons dans les mêmes connaissances. Ce sont les connaissances disponibles qui nous montrent comment les systèmes évoluent, comment les sociétés se succèdent, comment une croissance infinie dans un monde fini est mathématiquement impossible, comment il est impossible de continuer à brûler en un jour ce que la terre a accumulé pendant des centaines de millions d’années. Ou comment il est, simplement, impossible que trois milliards de Chinois et d’Indiens puissent un jour rejoindre le niveau de vie du milliard d’Occidentaux, conduire des voitures et lire des journaux au même rythme : il n’y a ni acier, ni pétrole, ni bois en quantités suffisantes sur la planète pour pouvoir y arriver. Ceci faisant que même les bourgeois sont obligés d’admettre que «quelque chose doit changer». Mais nous, nous avons la possibilité d’aller bien plus loin dans la critique, en envoyant une bordée de boulets là où leur idéologie se plonge dans leur portefeuille, qui leur impose d’établir le bilan de fin d’année en utilisant la méthode partagée par tous leurs semblables : ils doivent calculer le PIB, le produit intérieur brut, obtenu sur la base de la valeur ajoutéè, en l'homologant par dessus le marché à la somme des revenues, rien d’autre que le Wert total, la survaleur plus le salaire. Ils appliquent ainsi l’essence du Capital de Marx en même temps qu’ils nient la loi de la valeur !
Comme nous l'avons dit la prévision n'est donc pas neutre. Or, par une telle affirmation, si nous prétendons que prévision signifie aussi possibilité et probabilité qu'un événement se produise, nous soulevons un problème de logique. Imaginons un grand spéculateur international investissant d’importantes sommes sur la baisse de la livre sterling. Il est évident que si la somme dont il dispose est suffisante son investissement contribuera à la baisse de la valeur sur laquelle il spécule (le cas est réel, il s’agit de Georges Soros en 1992, la théorie de Soros de la «réflexibilité» est empruntée au philosophe Popper). Les scientifiques et les philosophes ne sont pas tous d’accord sur le concept de l’action du futur sur le présent, mais l’exemple peut être étendu et l’autopoïèse (la propriété d'un système à se produire lui-même et à se maintenir, à se définir lui-même) des phénomènes est une donnée de fait. L’historien américain Adam Ulan raconte, en exprimant son mépris, de quelle manière un insignifiant groupuscule de «partisans», pas tous d’accord entre eux, se regroupe en 1903 autour de Lénine. C’est vrai, mais ce serait une véritable exaltation du volontarisme que de penser que ces quelques fous ont été les artisans de la révolution d’Octobre. Ceux-ci s’étaient cependant trouvés en syntonie avec le «mouvement réel» de la société et avaient donc pu constituer un parti ayant des attaches parmi les ouvriers. Ils avaient prévu des mouvements sociaux et leur programme prévoyait la prise du pouvoir. C’est un fait que, à la faveur de l’explosion sociale, ils contribuèrent à la réalisation de leurs prévisions : à travers la révolution de 1905, le parti accrut son influence, et en 1917 il se présenta comme l’unique facteur de l’histoire et prit quasi automatiquement le pouvoir.
Les bourgeois peuvent naturellement eux aussi contribuer à la réalisation de leurs propres prévisions. Ils furent contraints, face à l’avancée de la révolution, et sur la base de leur idéologie conservatrice, de mettre en place dans le monde entier une politique de contre-révolution et de contrôle économique et social (fascisme, keynésisme). Politique qui eut un succès que, terrorisés comme ils l’étaient, ils n’attendaient pas. Ils arrivèrent à bloquer le développement révolutionnaire et ensuite se débarrassèrent de ceux qui avaient fait le sale travail pour leur compte, tout en continuant une politique de contrôle. Mais les bourgeois, comme les autres, doivent faire leurs comptes avec les lois de la nature. Le système capitaliste agit selon ses propres lois face auxquelles tant l’idéologie que les sbires ne peuvent pas grand-chose, même si néanmoins ils aident. Par exemple, on ne peut pas voter au parlement sur la validité ou la fausseté du second principe de la thermodynamique : le capitalisme est dissipatif, il gaspille des quantités épouvantables d’énergie et est donc condamné à «s’éteindre». Bien avant que cela n’arrive de nouvelles forces sociales exploseront, des forces adaptées au changement, et qui sont déjà présentes dans la société bourgeoise ainsi qu’elle est (Grundrisse, édition 10/18, vol. 1 p. 159). Le contraire est aussi vrai : Lénine n’a pas nié la possibilité théorique d’un superimpérialisme ; il a nié qu’il puisse se réaliser, car la société tout entière aurait sauté avant.
La probabilité n’existe pas
Cette auto réalisation de la révolution met à mal le déterminisme mécaniciste, la «causalité» philosophique a priori. Sur ce point, il faut faire attention, car les relativistes indéterministes accusent le marxisme de déterminisme mécaniciste. Nous ne sommes pas responsables de la sottise d’autrui, nous disons seulement que la dialectique est l’étude des relations, c’est-à-dire des causes interagissantes : une cause qui détermine une rétroaction sur elle-même ne fait pas sauter la construction déterministe, elle impose seulement que l’on soit attentif aux pièges aprioristes. L’autopoïèse de la révolution par l’intermédiaire du parti n’est rien d’autre que le «renversement de la praxis» dont nous avons parlé, mis en évidence par notre courant au cours des années vingt et précisé dans les schémas théoriques de 1951. Ce n’est pas une invention isolée due aux défaites face à la contre-révolution bourgeoise — surtout au moyen de sa variante stalinienne —, mais un produit du cerveau social (cf. : Einstein et quelques schémas…, n+1, n ° 4, p. 30). Ce sont les mêmes déterminations sociales qui produisirent une «Gauche communiste» en Italie, et produisirent également des courants scientifiques de haut niveau, parmi lesquels, en réaction au courant international «formaliste», les mathématiques «intuitives». Certains énoncés de ce courant scientifique sont de la même teneur que ceux que nous trouvons dans les écrits de notre courant révolutionnaire (même s’ils ne s’y réfèrent pas directement très souvent).
Dans le cas des phénomènes complexes, l’intuition, basée sur des connaissances antérieures, peu importe si celles-ci sont de nature instinctive ou analytique, a plus de puissance qu’un «calcul de probabilités». Nous sommes sûrs que le communisme ressortirait comme «peu probable», voire quasi impossible, sur la base d’un tel calcul ; et quiconque se baserait sur celui-ci pour établir une prévision aurait «mathématiquement» raison. Mais si la nature fonctionnait selon le calcul des probabilités, il ne se passerait rien, et nous, organismes vivants et pensants, ne serions pas là. Une ville, un réseau ferroviaire ou même une tasse de café sont des réalisations que la nature considère comme extrêmement improbables, mais elles sont bien là. Philosophiquement et religieusement, les hommes ont essayé de trouver une réponse à cela, mais ici nous nous limiterons à quelques chiffres pour démontrer que la révolution… révolutionne aussi le monde du probable. En 1998, il y eut trois fortes baisses à Wall Street durant le seul mois d’août. Les spécialistes de la bourse dirent que compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un mois de congés, ajouté à d’autres paramètres, les chances pour que se produise un tel événement étaient de 1 sur 500 milliards. L’année précédente, il y avait eu la «crise asiatique» avec des répercussions à Wall Street dont la probabilité avait été estimée à 1 sur 50 milliards (une chute de 7,7 % en un seul jour due à des causes exogènes) ! Et quelques années après, en 2002, il y eut trois lourdes baisses successives en sept jours, probabilité de 1 sur 4 000 milliards. Mais le record avait été atteint en 1987 : une chute de Wall Street de 29,2 % en un seul jour, avec des chutes en rafale les jours suivants. Une probabilité de 1 sur 1030, un chiffre qui ne peut se commenter. Ces événements «impossibles» arrivent à tout instant. Bien qu’il soit difficile de les prévoir, il est certain qu’ils arriveront : probabilité de 100 %. Nous avons une foi inébranlable dans ce type de probabilité.
Dans un texte de 1912 — Idéalisme socialiste —, un représentant de la jeunesse socialiste italienne affirma que le révolutionnaire a foi dans la révolution ; non pas comme le catholique qui a foi en Christ, mais comme le mathématicien qui a foi dans le résultat de ses recherches. Il s’agit d’une foi un peu particulière, celle que nous avons appelée un mélange de passion et d’algèbre. La foi du scientifique, comme le dit Einstein, est une impulsion intuitive qui explose sur un substrat de connaissances acquises et partagées. La nouvelle découverte est un saut rendu possible par l’esprit scientifique, lequel à son tour s’est formé par l’étude, la réflexion, l’expérimentation et les reproductions empiriques. Aucun pas en avant de la connaissance scientifique ne provient de l’énonciation de principes ou de vérités a priori provenant d’un quelconque philosophe.
L’acte de prévoir est «subjectif» au sens où nous venons de le voir : celui qui le réalise prévoit avec certitude le résultat de son travail, et Marx note qu’ici se trouve la différence entre la meilleure des abeilles et le pire des architectes. Étant subjectif, le fait de prévoir possède un vaste champ d’application qui va de la tentative à deviner sans rien savoir des variables possibles qui influencent le résultat (un lancer de dés) à la certitude réaliste pour un événement extrêmement probable (un projet à mener à bonne fin). Dans le cours de l’étude du modèle dont nous avons parlé (celui de 1957) il est clairement dit que les mathématiques ne servent que de support analytique à ce qui est une conviction, par ailleurs due à de solides raisons. La causalité (le déterminisme) n’est pas une idéologie, c’est un instrument de recherche pratique qui a révolutionné la science ; et si de nouvelles découvertes nous imposent une définition plus précise, ce n’est pas pour autant que nous devons nous sentir obligés de courir pour défendre la «vieille» conception ou pour parrainer la «nouvelle». Depuis au moins l’époque de la Grèce antique, l’homme a oscillé entre une conception du monde continue ou atomiste. Le principe de causalité a été «vrai» pour des périodes historiques entières et les scientifiques l’ont utilisé de manière pragmatique sans l’ériger en absolu ; ceci vaut également pour des phénomènes qui ne sont pour le moment traitables que par la méthode statistique, comme la mécanique quantique.
Lorsqu’on parle de probabilité, il faut comprendre que celle-ci n’existe pas dans la nature, mais est une convention humaine. Ainsi, lorsqu’on prévoit un certain pourcentage de résultats probables pour un phénomène possible, on pénètre dans un monde complètement subjectif. Si, dans un sac de jetons pour la tombola, il y a 90 jetons numérotés, les choses s’arrêtent là du point de vue des lois physiques. C’est l’action de prélever un des jetons qui nous permet de parler de la probabilité de 1 sur 90 pour tirer le numéro auquel on avait pensé. Mais nous ne pouvons appliquer le concept de probabilité à la prévision d’une éclipse : là existent des lois de la nature contraignantes, bien que Poincaré ait démontré que cela valait seulement pour une période de temps, car, à longue échelle, même pour un système planétaire composé simplement de trois corps, les influences gravitationnelles réciproques rendent le système imprévisible.
De toute façon, les prévisions de l’ordre du milliard d’années ne nous servent à rien pour la révolution mondiale. Les êtres humains, révolutionnaires ou non, compliquent énormément les choses, car ils ne peuvent éviter de perturber l’univers environnant, de regarder dans le sac de jetons de la tombola pour y trouver le numéro qu’ils veulent, jusqu’à en perturber les règles. L’élément subjectif est inséparable du processus révolutionnaire : il ne naît pas de la somme arithmétique de la volonté de chaque individu, mais d’une synthèse historique qui représente une volonté collective, ou, si l’on veut, d’une moyenne statistique des volontés.
Pour éviter toute équivoque probabiliste, disons tout de suite que pour nous l’élément subjectif, le dépositaire de la volonté et donc de la puissance et de la connaissance nécessaires pour influer sur les événements, est un élément suprapersonnel, c'est-à-dire le parti révolutionnaire, un cerveau collectif qui se concrétise sous la forme d’un organisme politique de type nouveau, sachant baser son action sur les lois du changement social. Le passage de Struttura que nous avons cité partiellement dans le chapitre «un modèle de prévision en 1956» où l’on affirme que l’on ne fait pas appel à la méthode analytique, mais à l’induction probabiliste, commence par le refus des théories probabilistes absolutisées en principe philosophique. Les nouvelles théories (principalement la théorie cinétique des gaz, la théorie statistique de l’entropie et la mécanique des quanta) ne doivent pas être reconduites dans l’apriorisme ; elles ont simplement contribué à libérer la science de certains apriorismes faisant que la science elle-même, pour l’instant à travers bien peu de ses représentants bourgeois, s’est rapprochée du monde réel, de la sensibilité de l’homme, de ses capacités biologiques de ne faire d’abord que des prévisions possibilistes, conjoncturelles, voire instinctives, qui ne sont rationalisées que par la suite. Confrontons cette position à certains passages de textes de la Gauche Communiste «italienne» :
« Les groupes humains sont partis de tentatives de connaissance du futur avant d’avoir édifié des systèmes de connaissance des événements passés. La première méthode est la tradition héritée de notions concernant la manière de se prémunir des dangers et des cataclysmes ; l’enregistrement, même embryonnaire, de faits et de données contemporains et passés ne vient que plus tard. La chronique naît après le pragmatisme. Un instinct identique à celui des animaux, réduit à un volume quantitativement bas de connaissances, permet de régler le comportement en fonction d’événements futurs qu’il faut éviter ou au contraire faciliter : un spécialiste de cette science en donne une belle définition : «l’instinct est la connaissance héréditaire d’un plan spécifique de vie». Tous ceux qui élaborent des plans travaillent sur les données du futur. Parcourant le cycle de l’espèce, on peut dire que le communisme est la «connaissance du plan de vie de l’espèce» »(Propriété et capital, chap. XVII).
« La différence ne réside donc pas dans celle entre art et science, entre intuition et intelligence. C’est grâce à l’intuition que l’humanité a toujours avancé, car l’intelligence est conservatrice alors que l’intuition est révolutionnaire. L’intelligence, la science, la connaissance ont pour origine l’avancée du mouvement. La connaissance, dans sa partie dynamique décisive, avance sous forme d’intuition, de connaissance affective, non démonstrative ; l’intelligence vient après, avec ses calculs, sa comptabilité, ses démonstrations et ses preuves. Mais la nouveauté, la nouvelle conquête, la nouvelle connaissance n’ont pas besoin de preuve, elles ont besoin de foi ! elle n'a pas besoin de doute, elle a besoin de lutte ! elle n'a pas besoin de raison, elle a besoin de force ! Son contenu ne s’appelle pas Art ou Sciences, il s’appelle Révolution ! » (Du mythe originel à la science unifiée de demain, n +1 nº 15-16, p. 68).
Pour notre courant, donc, la connaissance est en rapport, en harmonie avec notre être biologique, de telle sorte que puisse exister, et pas seulement en concept, un «plan de vie de l’espèce». Mais comment cela se concilie-t-il avec l’exigence de prévision scientifique qui, comme nous l’avons vu, utilise les mathématiques pour éviter les erreurs ? Laissons parler un grand mathématicien (et épistémologiste illuministe, c'est-à-dire un «adversaire») :
« [Les mathématiques] seraient une créature peut-être parfaite, mais pratiquement stérile si elles devaient se limiter à leurs propres fonctions, et donc ne servir qu’à ordonner, énumérer et exposer sous différentes formes ce qui est déjà connu. Une science parfaitement et purement logique ne pourrait s’occuper de prévision, ce qui est pourtant son principal but, et la possibilité psychologique de coordonner les observations de manière significative et opportune serait alors discutable, étant donné que l’appréciation de son opportunité est essentiellement basée sur son utilité présumée ou prouvée pour établir cette prévision. La science a en fait comme but principal la prévision : la constatation «historique» qu’un fait s'est produit et s’est déroulé d'une certaine manière n’intéresse pas du tout le scientifique ; il devient au contraire un élément capable de le passionner s’il réalise la possibilité d'y construire des régularités, d'en déduire des lois, et donc des critères utiles pour une prévision possible. » (Bruno de Finetti, L’invention de la vérité, p. 113 de l’édition italienne).
Au cours des années cinquante et soixante, lorsque l’économétrie, c’est-à-dire la tentative d’application de la logique à l’économie afin de réaliser des modèles mathématiques pour en tirer des informations sur le futur, devint à la mode, notre courant ironisa sur cette «méthode de robot» en lui opposant la future science humaine libérée des entraves des conceptions passées (Thèses de Naples, 1965). Plus tard, dans les années soixante-dix, un économiste, Siro Lombardini, plaisantant, mais pas trop, revendiqua la supériorité de ce qu’il appela le «pifomètre », dans la mesure où le cerveau humain, en traitant les conceptions et les connaissances mémorisées plus l’expérience, donnait des résultats plus efficaces que les modèles mathématiques traités par ordinateur. On savait déjà, par ailleurs, que les formes de divination antique se basaient sur les capacités d’élaboration du cerveau, capable d’opérer des liaisons et des chaînes de relations complexes à partir d’un faible nombre de faits connus.
Reproposer un modèle de prévision révolutionnaire aujourd’hui
Un modèle de prévision cohérent avec ce qui a été élaboré par notre courant doit se baser sur des données réelles (statistiques) de l’«histoire» du système à l'examen, et, en même temps, les élaborer par le meilleur ordinateur qui soit, le cerveau social humain, pour mettre en mouvement cette combinaison d’intuition et de projet dont nous avons parlé. Par cerveau social, nous entendons un être collectif pour lequel, de manière holistique, «le tout représente plus que la simple somme des parties» et soit pour cela capable de travailler sur des données historiques moyennant des connaissances et une mémoire tout autant historiques.
 Figure 1. Quatre types d’évolutions (courbes continues)
pour un système soumis à différents types de rétroaction suivant sa
«capacité de charge» (courbes en pointillé).
Figure 1. Quatre types d’évolutions (courbes continues)
pour un système soumis à différents types de rétroaction suivant sa
«capacité de charge» (courbes en pointillé).Nous disions précédemment que les systèmes complexes sont auto constructifs (ou auto destructifs), caractérisés par des rétroactions en mesure d’auto produire des modifications de leur dynamique. Interprétons la figure 1 (reprise du livre Au-delà des limites du développement) dans l’optique de la théorie révolutionnaire.
Dans la première case (A), nous avons un modèle à croissance continue de type auto constructif, c'est-à-dire à rétroaction positive : une partie de la valeur produite rentre dans le cycle productif ; c’est la reproduction élargie du Capital ; l'évolution est exponentielle, et le système est à l'abri de toute crise catastrofique car les limites physiques, c'est-à-dire les ressources et la possibilité de l’environnement de répondre à l’infini aux demandes de la croissance (capacité de charge) croissent, elles aussi, de manière exponentielle. C’est le modèle théorique de la bourgeoisie sur lequel se base l’économie politique.
Dans la deuxième case (B), nous avons le modèle «auxologique » [NDT : auxologie : science de la croissance] que nous évoquions au début, celui pris en compte par notre courant en 1956 : on suppose la capacité de charge du système fixe et l’on consigne de manière inductive, sur la série de données du passé, la loi de l’incrémentation décroissante dans le temps. Le système est encore à rétroaction positive, mais il passe d’une croissance exponentielle à une croissance asymptotique à travers un point de flexion. La prévision est réalisée par la projection de la courbe dans le futur. La courbe asymptotique montre une crise de la production de survaleur (chute tendancielle du taux de profit) que le Capital ne peut pas supporter — son axiome est A—A’ c'est-à-dire croissance ininterrompue. De l’induction [NdT : à la différence de la déduction qui impose des propositions de départ non supposées vraies, l'induction se propose de chercher des lois générales à partir de l'observation de faits particuliers, sur une base probabiliste] on passe à la déduction : la crise extrême du Capital impose des tentatives de revitalisation du cycle, et l’alternative devient : guerre ou révolution. Si nous ôtons la perspective révolutionnaire et la déduction conséquente sur la mort du système, il reste une courbe en «S », c'est-à-dire l’illusoire version réformiste qui l’interprète comme un équilibre entre capitalisme, limites physiques et société. C’est l’idéologie que l’on appelait opportuniste et qui aujourd’hui baigne l’ensemble du mouvement qui se croit de gauche. Des représentants de cette réaction néo-vendéenne sont, par exemple, les «partisans de la décroissance» suiveurs de Serge Latouche.
Troisième case (C). Le modèle d’il y a cinquante ans, comme nous l’avons souligné, à son niveau d'astraction ne tenait pas compte des interactions continues entre la croissance, les limites physiques générales (il n’y était considéré que les ciseaux entre production industrielle et production agricole) ainsi que les politiques mises en œuvre pour amortir les effets de la crise. Un modèle de ce genre, comme des camarades d’alors l’admettaient, aurait dû être reconfiguré de manière continue, en tenant compte des variations au fur et à mesure. Aujourd’hui, les simulations par ordinateur permettent d’introduire les rétroactions et d’en prévoir les effets. Au niveau d’abstraction le plus élevé, la troisième case permet de visualiser l’effet réciproque entre croissance et capacité de charge lorsqu’il y a intervention dans l’économie (fascisme, keynésianisme, stalinisme) à même de minimiser les effets des poussées spontanées dues au marché sauvage. Le système s’autorégule par des rétroactions négatives analogues à celles d’un thermostat, tendant ainsi vers l’équilibre (homéostasie) retombant dans la crise de valorisation. Dans notre étude sur un modèle de simulation de la misère croissante (n +1, nº 20) nous avons démontré que cette marche contrôlée vers l’équilibre est «entropique», c’est-à-dire, fait perdre de l’énergie au système et entraîne sa mort. En dèhors de cela, les interventions dans l’économie et celui des limites physiques se font toujours en retard par rapport à la manifestation d’états critiques, et leurs effets encore plus tardifs, entraînant le système dans un état de fibrillation, d’«état instable à la limite du chaos» comme le décrit la théorie de la complexité.
La dernière case (D) visualise un modèle économique résultant de la synthèse des trois premiers : la bourgeoisie base le maintien de son propre pouvoir sur un cadre de référence de type A où les limites physiques ne sont que l’objet de bavardages à l’ONU, au G8, au World Social Forum et dans d’autres assemblées parasitaires, et où l’économie politique continue obstinément à pousser à une croissance exponentielle. Cependant, la réalité, en contradiction avec l’idéologie et la praxis de la croissance, se porte vers des ajustements du type B et C, comme le démontre de manière transparente la crise actuelle dite des surprimes qui, depuis un an et demi, affole les économistes et les gouvernements. Le résultat est que les limites physiques sont dépassées par l’inertie du système, que les retards s’accumulent, tant en ce qui concerne les indices de l’économie politique que les réponses du système et de l’environnement. Les limites physiques subissent en conséquence une dégradation ultérieure jusqu’à ce que le système soit hors contrôle et se précipite vers la catastrophe.
Nous analyserons plus loin le diagramme à plusieurs courbes superposées exprimé dans un modèle réalisé par certains représentants de la bourgeoisie, modèle qui prend en compte les schémas B, C et D, utilisés pour réfuter l’hypothèse de croissance continue et illimitée du schéma A, celui que l’économie politique utilise comme seul point de repère. Mais maintenant que nous sommes familiarisés avec ces quatre schémas — ou modèles à niveau élevé d’abstraction —, voyons quels sont les diagrammes qui se réalisent sur la base de l’économie réelle, en commençant par l’évolution dans le temps des données d’un pays-type, les États-Unis. Nous les confronterons ensuite à ceux de la production industrielle des pays les plus développés — rappelons que l’évolution de la production industrielle est analogue à celle du taux moyen de profit. Pour ces pays nous disposons d’une grande quantité de données, bien que souvent fragmentaires et non tout à fait comparables, recueillies par un travail d'un demi siècle (cf. : Le cours du capitalisme mondial) couvrant le cycle allant de 1860 aux années quatre-vingt du XX.e siècle. Pour la production industrielle, nous avons poursuivi la série en cherchant à combler les lacunes ; nous ne visualiserons que la période allant de 1914 à 2008, ce qui est plus que suffisant pour le but que nous nous fixons. Des années 1980 à aujourd’hui, les données sont toutes de source officielle, principalement celles de l’OCDE. Nous soulignons la continuité du travail collectif dans le temps intégrant les mêmes critères et méthodes et complétant les données historiques. Pour approfondir ce travail, nous recommandons, outre le Corso déjà cité, Science économique marxiste comme programme révolutionnaire ; La crise historique du capitalisme sénile ; Dynamique des processus historiques – Théorie de l’accumulation. Commençons maintenant à introduire notre modèle et à faire parler les chiffres et les graphiques.
Dans la figure 2, qui provient de notre volume intitulé Dynamique des processus historiques, de 1992, les données étant mises à jour, on peut observer un point de flexion à partir de la moitié des années soixante-dix, c’est-à-dire un changement de la tendance historique de la production industrielle. La structure «fractale» des données est évidente : il y a ressemblance entre les différentes périodes et le cycle en entier, suivant la loi de Mandelbrot. Le caractère asymptotique de la courbe en «S » est prononcé.
 Figure 2. Indice de la production industrielle aux USA de 1860 à 2007 et courbe de tendance.
Figure 2. Indice de la production industrielle aux USA de 1860 à 2007 et courbe de tendance.Pour des raisons de compatibilité, l’intégration des accroissements relatis par année, tirés de la figure 6 , avec des données que nous utilisions en 1992 rapportés à l’indice 100 = 1913, est seulement indicative. Pour une évaluation exacte, nous donnons séparément les données mises à jour de 1990 à 2008 dans le graphe de la figure 2bis, à partir de laquelle il est également possible de relever la progression descendante :
| Augmentation de la production industrielle aux USA de 1990 à 2008. Source : OCDE, CIA Factbook | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| 1,7 | -2,7 | 0,8 | 3,4 | 5,4 | 4,9 | 4,5 | 6 | 3 | |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 2,5 | 2 | 4,5 | -3 | -0,4 | -0,3 | 4,4 | 3,2 | 4 | (0,5) |
 Figure 2 bis. Mise à jour des données de la figure 2 de la
production industrielle des USA. Le déroulement historique montre une
diminution médiane des accroissements relatifs (la ligne en gras montre la
moyenne des maxima et des minima pendant les 19 années considérées).
Figure 2 bis. Mise à jour des données de la figure 2 de la
production industrielle des USA. Le déroulement historique montre une
diminution médiane des accroissements relatifs (la ligne en gras montre la
moyenne des maxima et des minima pendant les 19 années considérées).La figure 3, toujours tirée du volume cité, montre de manière évidente non seulement l’évolution asymptotique en «S » mais également une diminution significative du nombre des ouvriers de l’industrie. Le point de flexion se situe autour des années cinquante et la baisse absolue commence dans les années quatre-vingt. Cette courbe est particulièrement significative, car elle indique, en plus de la flexion, de l’évolution asymptotique et de la structure fractale des années vingt et 30, les effets de l’augmentation de la productivité alors que dans la même période la population augmente régulièrement. Cette évolution est un révélateur classique de la loi de la chute du taux de profit. La mise à jour des années suivantes n’a pas été possible à cause de l’incompatibilité des séries (les tableaux actuels intègrent les données de l’industrie, des mines, des transports et de l’artisanat), mais l’évolution est cependant confirmée par des chiffres isolés provenant de diverses sources : face au maximum de 1980 indiqué dans la figure 3, soit 20 millions de salariés de l’industrie, nous trouvons 17,4 pour 2000, 16,2 pour 2005 et 15,9 pour 2007.
 Figure 3. Population ouvrière de l’industrie
manufacturière des États-Unis de 1900 à 1990. Données absolues et courbe de
tendance. La courbe est corrélée à celle du taux de profit à cause
de l’augmentation de la productivité qui
est toujours un indice de la diminution du nombre des ouvriers tant par rapport
au capital employé que par rapport à la valeur unitaire
des marchandises.
Figure 3. Population ouvrière de l’industrie
manufacturière des États-Unis de 1900 à 1990. Données absolues et courbe de
tendance. La courbe est corrélée à celle du taux de profit à cause
de l’augmentation de la productivité qui
est toujours un indice de la diminution du nombre des ouvriers tant par rapport
au capital employé que par rapport à la valeur unitaire
des marchandises.Évidemment, les statistiques américaines n’incluent pas l’énorme masse des illegal workers, dont on sait seulement qu’ils concernent 10 % des immigrés clandestins (12 millions selon le gouvernement, 20 millions selon une enquête des banques publiée par le journal USA Today). Dans la seule zone de Los Angeles et du sud de la Californie, le nombre des travailleurs au noir étant estimé à environ un demi-million, le chiffre total de 2 millions (10 % de 20 millions) est plausible. Les chiffres sur l’immigration et sur les travailleurs clandestins sont très significatifs, car ils sont un symptôme fondamental de la chute du taux de profit. Une des plus puissantes contre tendances à la loi de la chute est en fait le recours au travail dans une situation à basse composition organique de capital. Le secteur de la construction possède le plus élevé pourcentage de clandestins, 15 % de la force de travail. À ceci, il faut ajouter la délocalisation de secteurs entiers de la production, au Mexique et en Chine en ce qui concerne les USA.
 Figure 4. Prix des principales matières premières
minérales et agricoles de 1860 à 1980.
Figure 4. Prix des principales matières premières
minérales et agricoles de 1860 à 1980.La figure 4 (toujours tirée du volume cité) montre la courbe classique de l’évolution du prix des matières premières. Nous avons utilisé les prix non corrigés de l’inflation dans la mesure où c’est significativement leur évolution qui y contribue, tandis que la valeur des produits de l’industrie manufacturière tend historiquement à descendre. Le graphique ne montre aucun signe de structure fractale, car la loi de la rente ne permet pas le rattrapage des cycles mineurs du système, sinon de manière partielle et éphémère : le caractère volcanique de la production, théoriquement infini, trouve ses limites dans la limitation physique des ressources de la terre, ressources fortement hypothéquées par l’existence de la propriété.
La figure 5 complète l’évolution jusqu’à nos jours. Les deux graphiques ne sont pas intégrables à cause des différentes échelles et surtout à cause de la différence des «paniers» de matière première qui y sont contenus. Le même pic est cependant bien visible en 1972 et 1981. La stabilité relative de la courbe avant cette période, depuis 1860, et les hausses qui y succèdent, montrent un changement d’époque dû à la croissance exponentie lle de la production qui entre en contradiction avec la finitude des ressources. D’où l’explosion de la rente et donc du capital fictif, du au drainage de la survaleur et à sa conversion en crédit bancaire, lequel, à son tour, en l’absence de valorisation possible dans la sphère productive, génère une masse monétaire «spéculative». Il s’agit d’un processus historique irréversible. L’énorme drainage dû à la rente va gonfler le capital financier déjà existant, nettement supérieur au capital industriel. Sa valorisation dans le secteur productif se fait encore plus problématique, et dans la recherche frénétique de profit ou d’intérêt, tout devient vendable ; ce n’est plus seulement le capital qui devient fictif, mais aussi le travail humain des «services» qui semble produire des valeurs alors qu’en réalité il ne fait que les répartir dans la société. D’où l’inflation, qui dépassa les 20 % après la crise du pétrole. Lorsque, face à ce mécanisme, il n’y a pas d’inflation, et de plus que le prix des matières premières baisse (cf. l’effondrement de 2008), cela signifie que l’ensemble du système est malade, à partir de la flexion de la fondamentale production de survaleur. La crise financière n’est pas la maladie, mais sa fièvre.
 Figure 5. Prix des principales matières premières de 1956
au premier semestre de 2008.
Figure 5. Prix des principales matières premières de 1956
au premier semestre de 2008. Figure 6. Diagramme des augmentations relatives de la
production industrielle des principaux pays (donnée de juin projetée en
décembre). L’augmentation de la production industrielle suit fidèlement
celle du taux de profit.
Figure 6. Diagramme des augmentations relatives de la
production industrielle des principaux pays (donnée de juin projetée en
décembre). L’augmentation de la production industrielle suit fidèlement
celle du taux de profit.On voit que le système est malade dans la figure 6 qui, avec les figures 7 et 8, toutes tirées des mêmes séries historiques, est la plus intéressante de cette étude. Elle met en évidence la synchronisation progressive des principales économies, c’est-à-dire la courbe historique asymptotique des accroissements relatifs de la production industrielle. Ce diagramme est d’une importance fondamentale, car il révèle une contradiction inguérissable du système : l’impossibilité où se trouvent les pays les plus importants de produire, exporter des marchandises, exporter des capitaux et s' étendre tous ensemble dans la planète mondialisée. Les données concernant la Chine, relatives à ces dernières années, montrent qu’elle ne se trouve pas insérée dans cette situation. Il en est de même pour l’Inde. Mais la « mondialisation » est à la fois une voie de sauvegarde et un péril mortel pour le capitalisme : un Capital prenant toujours plus de distance par rapport à ses bases, celles de la propriété et de la nationalité, devient incontrôlable. Et ce phénomène ne peut que se renforcer. Un grand nombre de marchandises, au sein de la répartition internationale du travail, ne sont plus produites par les industries des vieux pays capitalistes, et la production se déplace vers les pays émergents qui disposent soit d’une force de travail à bas coûts, soit des technologies les plus récentes, soit de nouvelles organisations financières bien aguerries. La conséquence est que les cinq ou six pays de capitalisme récent pourraient, à brève échéance, représenter à eux seuls la totalité de la production industrielle mondiale. Ils auraient dès aujourd’hui la capacité de satisfaire la demande de l’ensemble des biens de consommation, même durables, du monde entier. Et ils entament la production des moyens de production du secteur primaire.
Mais la production industrielle coïncide grosso modo avec la production de survaleur — travail productif — et donc l’accumulation mondiale tend à se polariser, à faire en sorte que les vieux pays capitalistes, dont le PIB est désormais constitué par les services à 80 %, sont maintenant en situation de tributaires vis-à-vis des nouveaux pays industriels. (Ceci explique par exemple la position des États-Unis dans sa confrontation avec la Chine). En outre, tous les pays industriels, vieux comme jeunes, doivent payer un énorme tribu à la rente foncière (pétrole et autres matières premières), laquelle se transforme immédiatement en capital financier, aggravant la tendance à l’autonomisation du capital mondial.
 Figure 7. Évolution de la production industrielle/taux de
profit pour les USA, l’Angleterre, l’Allemagne, la France, l’Italie et le
Japon des années cinquante à 1980.
Figure 7. Évolution de la production industrielle/taux de
profit pour les USA, l’Angleterre, l’Allemagne, la France, l’Italie et le
Japon des années cinquante à 1980.L’agrandissement (Figure 7) d’une partie de la figure 6 permet de mieux visualiser la synchronisation progressive, particulièrement la chute de 1975-1976 et la période qui y succède immédiatement. La synchronisation extrême des économies industrielles à partir de 1975 est exclusivement due au drainage des valeurs à la suite du décuplement des prix du pétrole. Si nous enlevions le Japon, l’économie à l’époque la plus vivante (ligne du haut), la synchronisation serait encore plus évidente.
 Figure 8. Augmentation relative de la production
industrielle/taux de profit de 1870 à 1982 pour les principaux pays. Les
courbes en gras indiquent la moyenne des maxima et celle des minima met en
évidence les deux grandes synchronisations, celles de la crise de 1929 et celle
de 1975. La diminution finale de l’écart entre les deux bandes indique la
perte d’énergie du système.
Figure 8. Augmentation relative de la production
industrielle/taux de profit de 1870 à 1982 pour les principaux pays. Les
courbes en gras indiquent la moyenne des maxima et celle des minima met en
évidence les deux grandes synchronisations, celles de la crise de 1929 et celle
de 1975. La diminution finale de l’écart entre les deux bandes indique la
perte d’énergie du système.La figure 8 met en évidence la perte historique d’énergie du système. Les données utilisées sont celles ayant servi pour le diagramme 6 et sont tirées du modèle des années cinquante (mis à jour jusqu’en 1982). Il y a croissance pour tous les pays de 1870 à 1900, puis les oscillations s’amplifient pour se synchroniser vers le bas avec la crise de 1929. La reconstruction après la Seconde Guerre mondiale donne une évolution presque toujours positive, avec des écarts restants importants. Puis les économies se synchronisent et chutent en 1975, avec par la suite des oscillations minimes, tout comme un encéphalogramme qui, après la mort clinique du sujet, devient inexorablement plat.
Au fur et à mesure de l’accumulation du Capital, l’économie se financiarise, la capitalisation en Bourse augmente, les oscillations du prix des actions aussi, comme le montre la figure 9. L’évolution de l’indice Dow Jones offre une vision claire de ce processus : la plus grande catastrophe financière, celle de 1929, est pratiquement imperceptible sur le diagramme historique. On note à peine plus celle de 1987 où Wall Street avait perdu en une journée pratiquement le tiers de sa valeur. Mais à partir du milieu des années quatre-vingt-dix, on note une montée des prix très raide, justifiée par le succès éclatant des nouvelles technologies, mais en fait un épanchement de capital vers une branche de la production qui, à la différence des branches classiques qui demandaient des investissements en usines, infrastructures, force de travail, technologies, méthodes, ne pouvait pas remettre en mouvement l’économie. Ce même diagramme montre la fibrillation de 1997-2000 avec une chute de prix d’une ampleur jamais rencontrée jusqu’alors. Sans les répercussions sur la société qui eurent lieu lors des périodes d’oscillation passée, notamment lors de la Grande Crise de 1929.
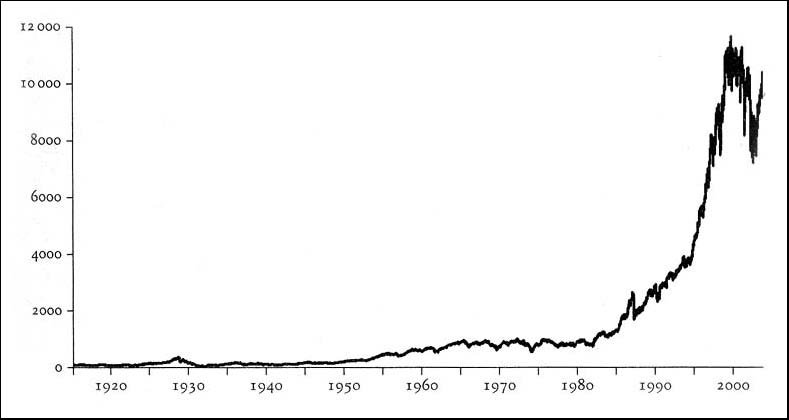 Figure 9. Indice Dow Jones des principaux titres de la Bourse
de New York de 1916 à aujourd’hui. Valeur absolue des relevés journaliers.
Figure 9. Indice Dow Jones des principaux titres de la Bourse
de New York de 1916 à aujourd’hui. Valeur absolue des relevés journaliers.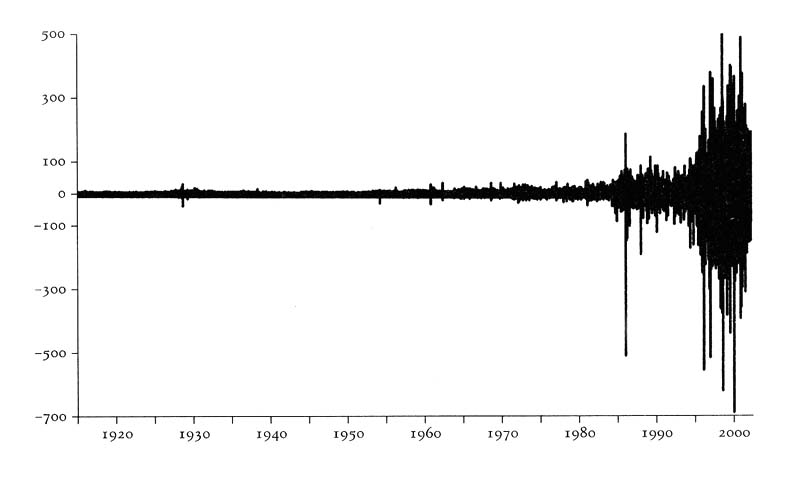 Figure 10. Indice Dow Jones des principaux titres de la
Bourse de New York de 1916 à aujourd’hui. Variations journalières des
valeurs absolues.
Figure 10. Indice Dow Jones des principaux titres de la
Bourse de New York de 1916 à aujourd’hui. Variations journalières des
valeurs absolues.La figure 10 comporte les mêmes données que la figure 9 mais exprimées en variation journalière des valeurs absolues. La valeur totale de la capitalisation de la bourse à Wall Street croissant avec une dynamique identique à celle de la production industrielle, les variations de l’indice journalier mesuré en valeur absolue paraissent fortement amplifiées. Par exemple, la chute en pourcentage de 1929 fut élevée, mais la bourse capitalisait bien moins qu’aujourd’hui et donc la baisse en valeur fût moindre. Aujourd’hui, la bourse capitalise beaucoup plus et donc même une faible variation en pourcentage donne une oscillation plus grande lorsqu’elle est mesurée en valeur. Les oscillations de 1929 apparaissent de fait peu visibles alors que celles comprises entre 1987 et 2000 sont très amples, de – 700 à + 500 environ.
Le diagramme de la figure 10, montrant lui aussi un système en croissance auxoligique, est une image symétrique à celle du diagramme de la production industrielle (figure 6), où l'on voit un système allant d’une dynamique élevée à une oscillation autour de zéro. Dans le diagramma de la figure 10, qui représente la financiarisation, on voit un système qui va du calme relatif d’une économie encore basée sur les «fondamentaux» à la fibrillation paroxystique d’une économie folle qui tente de se délier, sans y réussir, de la production de survaleur du cycle industrie-service. Les deux «entonnoirs», parfaitement symétriques, montrent une des pires contradictions du capitalisme, identique à celle d’une colonie de bactéries en train de mourir : plus le niveau énergétique du système baisse (pour les bactéries une baisse de l’alimentation), plus les besoins d’énergie du système lui-même augmentent, chaque bactérie s’agitant désespérément contre les autres pour accaparer le peu d’énergie restante.
 Figure 11. Évolution de la valeur totale de la production
par secteur aux USA (source : Meadows, Au-delà des limites du développement.
Notre élaboration de 1990 à 2000)
Figure 11. Évolution de la valeur totale de la production
par secteur aux USA (source : Meadows, Au-delà des limites du développement.
Notre élaboration de 1990 à 2000)Déterminer avec précision quelles sont les dynamiques du capitalisme d’hier et de celui d’aujourd’hui est indispensable pour affronter son futur, car, comme nous l’avons vu, la seule utilisation des statistiques des données passées, ou leur simple traduction en formule mathématique n’est pas de la science. Ce n’est pas sans raison que certains épistémologistes affirment que les mathématiques ne sont pas une science, mais son instrument. Mais revenons-en aux États-Unis pour un instant. Si nous décomposons leur production totale — salaire + survaleur — entre les trois secteurs classiques : agriculture, industrie et service, nous obtenons le diagramme de la figure 11. Il représente l’évolution caractéristique des pays de vieille industrialisation présents dans le diagramme de la figure 6. Dans la formation de la valeur totale, la part due à l’agriculture est désormais négligeable, celle de l’industrie croît faiblement alors que celle des services explose. Nous ne sommes donc plus uniquement face à la minéralisation de la société, mais également face à une dématérialisation de la production de marchandises. Face aux services, marchandise immatérielle par excellence et qui représente désormais 80 % de la valeur produite par les sociétés occidentales, les autres marchandises ne comptent presque plus, sachant que de plus la partie «industrie» comprend également l’extraction minière, y compris le pétrole.


 n+1
n+1